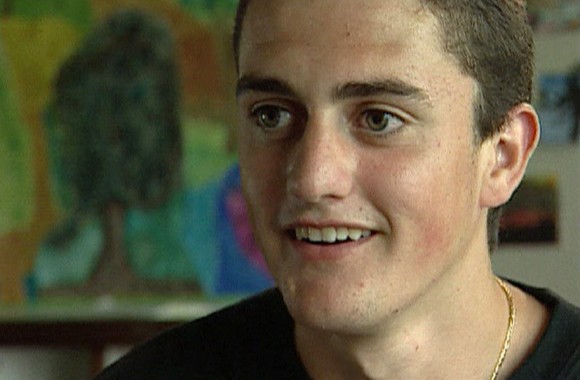LES CLASSES D’ACCUEIL
Les premières classes d’accueil de Lausanne ont été créées en 1988. Jusqu’alors, les élèves non francophones, principalement italiens, portugais ou espagnols, avaient la possibilité de suivre les cours intensifs de français pour essayer de rattraper le niveau scolaire des élèves suisses. Mais avec la diversification de la population migrante et l’afflux de requérants d’asile, l’instruction publique s’est rendu compte que le problème des étrangers ne se limitait plus à un problème de langue. D’une part, le niveau d’instruction des élèves devenait de plus en plus bas (certains enfants n’étaient même jamais allés à l’école avant de venir en Suisse) et d’autre part ils avaient parfois subi de tels traumatismes qu’il fallait pouvoir panser leurs plaies avant de leur enseigner la grammaire.
Melting-pot de cultures, ces classes regroupent des enfants dont la langue, la confession, l’âge et le niveau scolaire sont très différents. Les effectifs dépassent donc rarement une douzaine d’élèves et l’enseignement y est plus lent, plus personnalisé, et plus particulièrement axé sur l’étude du français. De plus – crises et conflits obligent – de nouveaux élèves sont introduits en classe en cours d’année, ce qui alourdit le travail des enseignants. Pour Bernard Courvoisier, doyen des treize classes d’accueil lausannoises, “les enseignants prêts à effectuer ce travail doivent réaliser qu’il dépasse, et de loin, la pédagogie. C’est un travail social”.
En principe, l’enfant reste en classe d’accueil une année au moins avant de pouvoir réintégrer une classe “normale”. Les élèves arrivés en Suisse à l’âge de 13 ou 14 ans n’ont donc souvent pas le temps de rattraper le niveau d’une terminale avant la fin de leur scolarité obligatoire. Leur intégration dans le système de formation se révèle en effet fort difficile. Dans un système scolaire de plus en plus sélectif, accéder à des études supérieures ou à une formation professionnelle convenable paraît dès lors presque impossible. Aussi, dans le meilleur des cas, ils espèrent trouver, avec l’appui de leur enseignant, un stage rapide et précaire qui leur permettra d’exercer pour un salaire misérable, des besognes peu prisées par les Suisses.
Le cinéaste Fernand Melgar a réussi, dans «Classe d’accueil», à transmettre une image nuancée de l’insécurité intérieure et extérieure de ces jeunes «immigrés»; il y parvient sans apporter de commentaire, en donnant la parole aux intéressés. Il saisit des moments heureux mais aussi mélancoliques dans la vie de ces jeunes, en touchant au registre des émotions; il soulève de nombreuses questions, notamment à propos de l’identité des jeunes, de la Suisse terre d’asile, de la xénophobie. Les personnes interrogées dans le film s’expriment librement sur des thèmes souvent délicats. C’est également le cas de l’habitante du quartier qui, elle-même Française, se plaint du grand nombre d’étranger et d’étrangères dans sa ville. Ses propos sont représentatifs pour beaucoup de Suisses qui n’ont pas la même attitude selon l’origine des réfugiés. Bruno le jeune Portugais a plus de facilité à se faire accepter qu’Amir venu de Bosnie; mais les peurs quant à l’avenir sont les mêmes pour tous les deux.
Tandis que les jeunes réfléchissent à haute voix sur leur vie entre deux cultures et leur avenir professionnel devant l’arrière-plan idyllique des Alpes valaisannes, nous nous trouvons, en tant qu’observateurs, confrontés en même temps à la question de l’identité de la Suisse. Il en résulte une situation paradoxale: les jeunes étrangers/étrangères admirent un pays qui se trouve lui-même à la recherche de son identité. La déclaration d’Amir – «quelquefois, j’aimerais bien être Suisse» – ne doit pas faire oublier que les enfants continuent d’être marqués par les horreurs de la guerre en Bosnie et que dans ce contexte, la Suisse signifie pour eux tout bonnement «la vie». Quoi qu’il en soit, ces points de vue contrastés sont propres à susciter des discussions intéressantes, entre autres sur le rôle de la Suisse comme pays d’accueil pour les réfugiés.
Le film transmet malgré tout un message d’espoir, surtout par les portraits impressionnants des jeunes qui, grâce à leur volonté de vivre et à leur manière de faire face à leur avenir incertain, tentent de surmonter leur passé.
PORTRAITS
Anne Juri vit avec passion son métier d’enseignante de (ou en) classe d’accueil: « Pour moi c’est un travail social très intéressant qui m’amène énormément. De la joie, du bonheur, de voir un petit peu de soleil parce que les élèves sont heureux de venir en classe. Et moi, ça me fait plaisir de les accompagner un petit bout de chemin. On ne sait pas ce qu’ils vont devenir, mais ce petit bout de chemin est là. »
Béa: Je me demande si on ne pourrait pas ajouter un peu plus, pour bien montrer l’aspect positif du début: Je pense que s’ils ont un moment où ils sont bien, s’ils arrivent à trouver une certaine force dans leur personnalité, j’ai l’impression qu’ils ont plus d’outils pour aller de l’avant.Mais bien souvent, la joie d’enseigner fait place au doute: « C’est vrai qu’il y a des moments où je trouve que c’est dur, que dire adieu à un élève qui va partir on ne sait où, ce n’est pas évident. Le retour est très difficile. Je me pose la question: est-ce vraiment bien que ces élèves soient ici en Suisse, qu’on leur donne la possibilité d’avoir tout plein de choses? Et ils retournent vers quoi ? Est-ce que c’est bon ? Je ne sais pas. Mais les élèves sont là, on fait avec. Je fais au mieux selon ma conscience, ce que je pense être bien et utile pour ces enfants, Est-ce que c’est juste ou non ? Je ne sais pas. Je crois que le message important à donner aux élèves quand ils partent vers l’inconnu, c’est d’avoir confiance en la petite flamme et la force de vie qui est en eux. Ils auront des choses difficiles à vivre, des personnes qui essaieront de souffler sur cette flamme, mais ils peuvent compter sur elle: cette force de vie est là et ils vont tenir le coup. Il arriveront à affronter même des tempêtes si tempête il y a. »
Elvir, 11 ans, est requérant d’asile et vit en Suisse depuis un an. Rescapé de la guerre en Bosnie, il vit avec son petit frère et sa mère dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile. Ils logent à trois dans une chambre de 12 m2, équipée d’un lavabo et d’un frigo, dans un bâtiment vétuste, construit à l’origine pour accueillir les travailleurs saisonniers. La promiscuité, le bruit constant et le mélange des ethnies rend la vie dans le centre bien difficile à supporter. Elvir et sa famille y survivent tant bien que mal grâce aux maigres subsides que leur distribue la FAREAS (Fondation pour l’Accueil des Requérants d’Asile).
Comme le centre de Crissier est le plus grand de la région lausannoise, de nombreuses familles y ont été logées ces dernières années. Cet afflux d’enfants a nécessité l’ouverture de plusieurs classes d’accueil. Or la scolarisation de ces élèves semble aujourd’hui coûter trop cher à la commune – qui a déjà investit 40 millions de francs pour la construction du Collège de Marcolet ! – et Crissier ne veut plus assumer ces frais. Depuis septembre 97, le centre n’accueille donc plus que des célibataires et les familles sont déplacées dans d’autres lieux. Exceptionnellement, Elvir a été relogé avec sa famille dans la commune et pourra poursuivre sa scolarisation au même endroit, tant qu’il aura droit à l’asile en Suisse.
Bruno avait 15 ans lorsqu’il est arrivé en Suisse. Issu d’une famille de paysans portugais, il a été élevé par ses grands-parents puisque, pour des raisons économiques, son père et sa mère ont décidé de venir travailler en Suisse. Après plusieurs années de séparation dues au statut de saisonnier ( interdiction du regroupement familial) , ses parents ont réalisé qu’ils étaient en train de « perdre » leurs enfants. Ils ont alors pris le risque de les faire venir ici clandestinement. C’était la première fois que la famille se trouvait réunie.
Aujourd’hui leur nouveau permis B les met à l’abri des incertitudes du lendemain. Mais si Bruno est heureux d’avoir retrouvé sa famille, il n’oublie pas pour autant ses grands-parents qu’il considère encore comme ses vrais parents, « parce que c’est avec eux que j’étais habitué à vivre », dit-il. « Et puis la Suisse c’est bien pour travailler, mais pas pour vivre ». Son pays, ses copains lui manquent. Il vit d’ailleurs ici dans un monde presque exclusivement portugais: équipe de foot, copains, centre portugais où il passe tous ses dimanches et qui lui donne l’impression d’être dans son pays natal. Son but est de rester en Suisse encore quelques années pour terminer sa formation de monteur sanitaire, gagner un peu d’argent, puis de retourner au Portugal.
Pourtant, lorsque Bruno rentre chez lui pour les vacances, il réalise, comble d’ironie, que c’est la Suisse qui commence à lui manquer. A cheval entre deux cultures et deux familles, Bruno ne se sent finalement bien nulle part.
Mensura vient d’un petit village de Bosnie. Elle n’a que trois ans quand son père meurt et que sa mère l’abandonne. Recueillie par une femme âgée, Mensura passe quelques années sous son toit. Lorsque la guerre éclate, elle se trouve plongée au coeur des conflits les plus meurtriers. Transbahutée d’un coin à l’autre du pays par les casques bleus, elle saisit la première occasion pour s’enfuir seule clandestinement pour la Suisse. Elle a 14 ans à son arrivée et passe une année au Centre d’hébergement de la FAREAS à Crissier avant d’être relogée en appartement. Mineure non accompagnée, Mensura est soutenue par les services sociaux du canton de Vaud, notamment par un tuteur qui la représente légalement et tente de l’aider de son mieux.
Mensura fait partie des 180 cas qu’il a en charge et il ne peut malheureusement résoudre tous ses problèmes. A 16 ans, elle ne doit pas seulement apprendre le français et tenter de rattraper les années d’école qu’elle n’a pu faire dans son pays : confrontée quotidiennement à des responsabilités d’adulte et à des tracasseries administratives qui la dépassent, elle doit aussi imaginer son avenir professionnel et social, alors qu’elle ne sait pas si elle obtiendra le droit d’asile en Suisse. Droit qui semble en effet plus difficile à obtenir pour les mineurs non accompagnés, puisque seulement 0,5% d’entre eux reçoivent un permis de réfugié. A travers ses silences, on devine toute sa peur du retour dans son village occupé par les Serbes, où seule, elle devra faire face à ses ennemis d’hier.
Comme pour Bruno, on retrouve le même déchirement culturel et familial chez Nurten et Aynur, deux soeurs kurdes musulmanes, arrivées en Suisse il y a un an. Ce ne sont pas elles qui s’expriment dans ce portrait, mais leur père qui, depuis 1985, réside et travaille en Suisse. Coupé de sa famille à cause de son statut de réfugié, il lui a fallu attendre 7 ans pour retrouver les siens lors d’un cours séjour en Turquie. Arrivé à l’aéroport, il n’a pas reconnu ses enfants qu’il avait quittés en bas-âge.
En 1996, ses trois filles cadettes et sa femme obtiennent un permis d’établissement et le rejoignent à Chavannes-près-Renens. Le père a l’impression de renaître à la vie, même si son fils unique et ses trois autres filles aînées, mariées en Turquie, sont restés là-bas. Il se consacre désormais totalement à sa famille qu’il « cultive » un peu comme son petit jardin suisse dans lequel il sème des graines de Turquie. Cet attachement au pays, on le retrouve aussi chez ses filles qui restent fidèles à leur culture traditionnelle tout en s’adaptant progressivement à une vie plus européenne. Ainsi, Nurten, 16 ans, porte le voile à la maison, des jeans à l’école, et rêve de s’installer seule dans un studio.
Amir, 13 ans, a fui la Bosnie il y a 2 ans. Avec sa mère et sa soeur Minka, en classe d’accueil elle aussi, il vit dans un quartier de HLM à Crissier, au chemin des Noutes. Une bonne partie des appartements a été louée à la FAREAS pour pouvoir y loger les réfugiés et ceux-ci se trouvent confrontés aux anciens habitants, suisses ou immigrés des années 60, qui ont beaucoup de mal à accepter cette nouvelle population. Ce n’est pas qu’ils soient racistes, disent-ils, mais ils ne se sentent plus chez eux. Pire, « ce sont les réfugiés qui se croient chez eux en ne respectant pas les règles de vie du pays ». Quant aux étrangers arrivés en Suisse il y a une trentaine d’années, ce qu’ils reprochent à ces nouveaux-venus, c’est de vivre ici sans travailler, contrairement à eux.
Amir se plaît pourtant dans son quartier. A l’inverse de Bruno qui possède un permis d’établissement et rêve de retourner au Portugal, Amir, sans permis, espère encore pouvoir rester en Suisse où il a découvert la liberté et la vie. Sa hantise est de devoir retourner en Bosnie et d’y retrouver toute l’insécurité qui y règne, les voisins serbes et les mines antipersonnels. Pour l’instant, il consacre tous ses efforts à oublier la guerre en Bosnie. Hélas, il vient de recevoir la décision de son renvoi pour avril 1998. Il reste néanmoins persuadé qu’il reviendra un jour dans ce pays.
Jusqu’à 16 ans, Gülnaz a vécu en Turquie avec sa tante et sa grand-mère. Il y a deux ans, son père, émigré en Suisse, est allé la chercher, elle et ses trois frères cadets dont elle s’occupe aujourd’hui comme une vraie petite mère. Grâce à son dévouement et sa gentillesse, sa maîtresse de classe a pu lui trouver une formation d’aide-soignante dans un home pour personnes âgées mal voyantes. Pendant presque un an, chaque samedi, elle est allée y travailler bénévolement. Puis elle a suivi un stage de 3 mois cet été avant d’y obtenir un emploi fixe, rémunéré au plus bas. Il n’est donc pas étonnant que, comme elle, la plupart des aide-soignantes soient étrangères, africaines ou d’origine méditéranéenne. Elles entretiennent toutes une relation affective et quasi familiale avec leurs patients; leur culture,contrairement à la nôtre, a peut-être su garder un plus grand respect des personnes âgées.
Aujourd’hui, elle rêve en secret que son fiancé turc vienne bientôt la rejoindre.